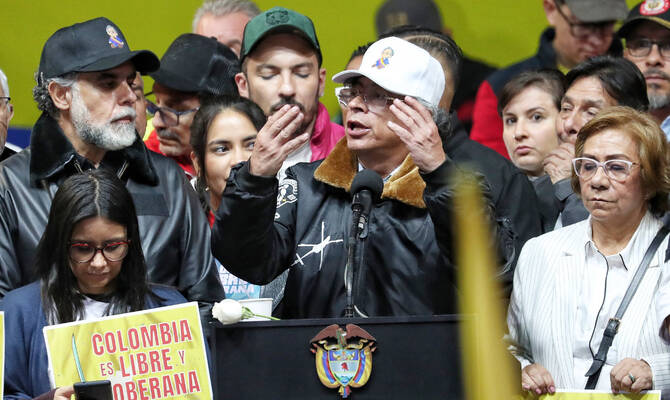Pakistan-Afghanistan : pourquoi Islamabad dément les frappes aériennes accusées d’avoir tué 10 civils, dont 9 enfants

Dans la nuit du 24 au 25 novembre 2025, plusieurs provinces afghanes frontalières — Khost, Kunar et Paktika — ont été touchées par des raids aériens qui, selon les autorités talibanes, ont fait au moins dix victimes civiles, dont neuf enfants et une femme, et plusieurs blessés. Face à ce bilan, Kaboul a immédiatement pointé du doigt l’aviation pakistanaise et promis une « réponse appropriée ». Cependant, Islamabad a catégoriquement démenti toute implication, un démenti qui s’inscrit dans une stratégie de communication militaire soigneusement calibrée et qui reflète une réalité opérationnelle bien établie.
Le lieutenant-général Ahmed Sharif Chaudhry, porte-parole des forces armées pakistanaises, l’a rappelé à plusieurs reprises : « Chaque fois que le Pakistan mène une opération contre des terroristes, elle est revendiquée ouvertement et avec tous les détails nécessaires. » Cette ligne directrice, constante depuis 2014 et l’opération Zarb-e-Azb, montre que les frappes menées contre le TTP (Tehreek-e-Taliban Pakistan) ou d’autres groupes dans le Waziristan ou ailleurs sont systématiquement annoncées par l’ISPR, le service de presse de l’armée. Par conséquent, un raid non revendiqué serait perçu comme une anomalie, susceptible de discréditer la narrative officielle d’Islamabad, celle d’une « lutte antiterroriste transparente ».
Même si le Pakistan considère certaines zones afghanes comme des sanctuaires du TTP, admettre un tel bilan exposerait Islamabad à plusieurs risques simultanément : une condamnation internationale immédiate, avec l’ONU, Amnesty International ou Human Rights Watch déjà très impliqués sur le dossier ; une rupture définitive avec les talibans afghans, avec lesquels Islamabad tente malgré tout de maintenir un canal minimal de dialogue ; ainsi qu’une radicalisation accrue au Pakistan, où l’opinion publique reste très sensible aux images d’enfants tués.
C’est dans ce contexte que le démenti prend tout son sens, car il permet de gagner du temps tout en semant le doute : ces frappes pourraient tout aussi bien provenir de drones américains encore présents, d’une opération sous faux pavillon, ou de groupes locaux. L’absence de revendication d’un autre acteur crédible renforce ainsi la crédibilité du démenti pakistanais.
La veille, l’attentat-suicide du 24 novembre à Peshawar, qui a fait trois morts et onze blessés parmi les forces paramilitaires, a été perçu comme une provocation directe par Islamabad. Selon l’armée pakistanaise, les attaquants étaient des Afghans et la cellule aurait été pilotée depuis le territoire afghan. Dans ce climat tendu, l’armée a pu décider d’une opération punitive ciblée, mais assumer publiquement un massacre d’enfants seulement 24 heures après un attentat qui mettait déjà en avant la « barbarie » du TTP aurait été politiquement et moralement impossible.
Ce scénario n’est pas inédit. En décembre 2022, des frappes sur Khost et Kunar avaient fait huit morts selon Kaboul, et le Pakistan avait démenti avant de reconnaître six mois plus tard qu’il s’agissait bien d’opérations contre le TTP. En mars 2023, de nouveaux raids avaient suivi le même schéma : démentis initiaux puis reconnaissance tardive. Ce schéma est désormais bien établi : démenti immédiat, enquête interne, puis reconnaissance a posteriori lorsque les preuves deviennent trop accablantes ou lorsque l’effet dissuasif est jugé atteint.
Si ce n’était pas le Pakistan, alors qui ? Pour l’instant, Islamabad n’a pas besoin de répondre. Son démenti suffit à maintenir la pression sur Kaboul tout en se protégeant des retombées internationales d’un massacre d’enfants, une application classique de la realpolitik frontalière.