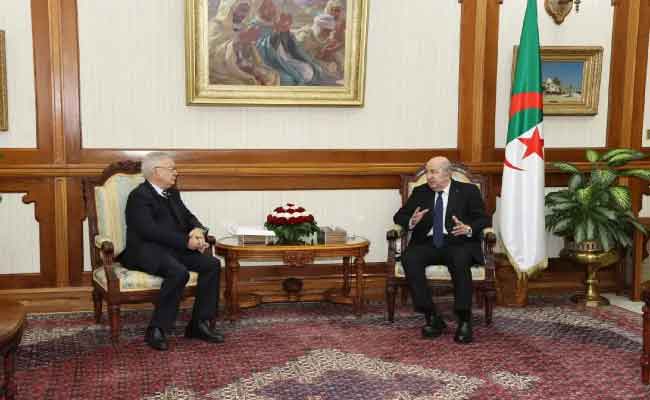Séisme sur le marché pétrolier : chute historique de près de 5 % en quelques heures sur fond de disparition de la prime de guerre russe

Londres, 25 novembre 2025 – Le marché pétrolier a vécu ce mardi l’une de ses séances les plus violentes depuis le début de la guerre en Ukraine. En à peine trois heures, le Brent de mer du Nord a perdu jusqu’à 4,8 %, tombant à 62,27 dollars le baril, son niveau le plus bas depuis octobre 2021. Le WTI américain a suivi le mouvement, dégringolant à 57,75 dollars (-1,85 % à 13 h 10 GMT).
Le choc a été déclenché à 12 h 47 GMT par une dépêche d’ABC News citant un haut responsable américain : une délégation ukrainienne venait d’accepter, lors de discussions avec Washington, le cadre révisé d’un accord de paix ramené à 19 points.
Le marché pétrolier a été secoué par des fuites révélant plusieurs signaux convergents vers une désescalade en Ukraine. Des réunions secrètes russo-américaines, tenues à Abou Dhabi les 24 et 25 novembre en présence du chef du renseignement militaire ukrainien, ont été confirmées. Parallèlement, le plan américain révisé, désormais soutenu par Kiev, n’exige plus le retrait total des forces russes avant un cessez-le-feu, levant ainsi l’un des principaux blocages diplomatiques depuis trois ans. Moscou laisse entendre qu’elle pourrait accepter un gel des lignes de front, une démilitarisation partielle et, surtout, une levée progressive des sanctions énergétiques dès début 2026. L’envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, est attendu à Moscou début décembre pour finaliser l’accord, envoyant aux marchés un signal clair : la guerre en Europe de l’Est pourrait approcher de son dénouement, et la disparition de la prime de guerre pourrait faire chuter le Brent de 15 à 20 dollars, une anticipation intégrée instantanément par les investisseurs.
Pour les traders, le message était limpide : la « prime de risque Russie », estimée entre 12 et 18 dollars depuis février 2022, s’évaporait brutalement. « On a assisté à une liquidation massive de positions longues. Les algos ont vendu sans réfléchir dès que le mot “accord” est apparu avec “Ukraine” », explique un opérateur de l’ICE à Londres. Plus de 1,8 million de contrats Brent ont changé de mains en trois heures, un record absolu pour une séance européenne.
Derrière cette panique se dessine le scénario redouté depuis trois ans : la levée progressive des sanctions énergétiques contre Moscou. Un accord de paix, même partiel, pourrait remettre sur le marché 3 à 4 millions de barils par jour de brut et de produits raffinés russes, dans un contexte où l’offre mondiale est déjà excédentaire. « Si Droujba reprend à plein régime et que les tankers russes peuvent à nouveau accoster en Europe sans détour par le Cap, on parle d’un tsunami d’offre », prévient Amrita Sen, analyste chez Energy Aspects.
Le calendrier accentue la correction : l’OPEP+ a reporté sa décision sur les quotas 2026, la demande chinoise reste morose, et Donald Trump, répète vouloir « du pétrole à 40 dollars » pour relancer l’économie américaine.
Conséquence immédiate : le rouble a bondi de 6 % face au dollar, les actions de TotalEnergies, Shell et BP ont chuté de 6 à 8 %, tandis que les taux de fret pour les tankers en mer Noire se sont effondrés de 18 % en une seule journée.
À 18 h GMT, le Brent se stabilisait autour de 62,50 dollars, mais la volatilité reste extrême. Un simple démenti du Kremlin ou une escalade militaire pourrait faire repartir les cours de 10 dollars dans l’autre sens.
Pour l’instant, une seule certitude prévaut : le marché pétrolier a vécu le jour où il a commencé, pour la première fois depuis trois ans, à croire sérieusement à la paix. Et cette perspective lui fait beaucoup plus peur que la guerre.