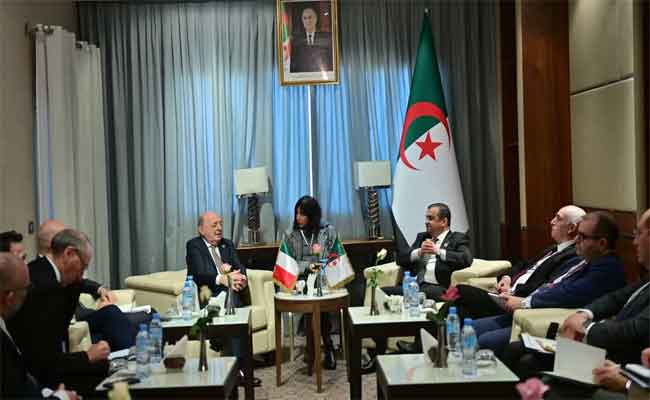Modernisation des Ports : Tebboune renforce-t-il réellement les fondements économiques?

Lors d’une réunion du Conseil des ministres, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé le rôle stratégique des ports dans l’économie nationale et la souveraineté du pays. Il a insisté sur la nécessité de renforcer ces infrastructures essentielles à la relance économique et à l’indépendance nationale face aux défis mondiaux. Cependant, derrière ces ambitions affichées, la réalité est plus contrastée. La modernisation des ports, souvent annoncée, peine à se concrétiser en raison d’une bureaucratie pesante, d’un manque de vision stratégique et de retards récurrents dans la mise en œuvre des projets.
Le président Tebboune a ordonné au gouvernement d’adopter de nouvelles mesures pour mieux protéger et moderniser les ports algériens. Ces infrastructures, vitales pour le commerce extérieur, doivent bénéficier d’une gestion plus efficace afin d’optimiser les échanges et d’attirer davantage d’investissements. L’objectif est de les transformer en hubs régionaux capables de rivaliser avec les grandes plateformes internationales. Or, ces ambitions se heurtent à des obstacles structurels : infrastructures vieillissantes, corruption endémique et lourdes administratives qui ralentissent considérablement les opérations portuaires. Pendant ce temps, d’autres pays du Maghreb, comme le Maroc avec Tanger Med, ont su attirer des capitaux et améliorer leur compétitivité, creusant l’écart avec l’Algérie.
Par ailleurs, le chef de l’État a plaidé pour une meilleure gestion de la consommation nationale de gaz et de produits pétroliers. Il prône une « approche scientifique » pour optimiser l’utilisation des ressources, préserver le pouvoir d’achat et encourager les investissements énergétiques. Toutefois, cette déclaration ne masque pas une réalité persistante : l’Algérie reste excessivement dépendante des hydrocarbures et aucune initiative significative de diversification énergétique n’a été mise en place. Les projets d’énergies renouvelables avancent trop lentement, et les subventions sur le carburant continuent de peser lourdement sur le budget de l’État, freinant toute réforme structurelle. Sans une politique énergétique claire et proactive, la sécurité énergétique du pays demeure fragile, laissant l’Algérie vulnérable aux fluctuations du marché mondial.
Dans le cadre des efforts de relance industrielle, le président Tebboune a donné des instructions pour accélérer la remise en service d’une usine de ciment avant la fin mars, inscrivant cette initiative dans un programme de lutte contre la corruption. Pourtant, les annonces répétées de relance industrielle n’ont jusqu’ici abouti qu’à des résultats mitigés. La rigidité administrative, les lourdes bureaucratiques et le manque de clarté dans les politiques de soutien aux investisseurs empêchent le secteur de réellement décoller. De nombreux projets annoncés dans le passé ont été retardés, voire abandonnés, faute d’une planification efficace et d’un suivi rigoureux.
De plus, il a exigé l’achèvement des procédures nécessaires pour permettre l’ouverture de l’usine de trituration des oléagineux de Kotama, dans la province de Jijel, avant la fin du mois de mars. Si cette unité est censée renforcer l’autosuffisance alimentaire et réduire la dépendance aux importations, il reste à voir si sa gestion sera à la hauteur des attentes. Trop souvent, les projets industriels en Algérie souffrent d’une mauvaise planification et d’un manque de suivi, ce qui conduit à des retards, des surcoûts et parfois même à l’abandon pur et simple. La volonté de relancer l’industrie ne suffit pas si elle n’est pas accompagnée de réformes structurelles garantissant un cadre stable et attractif pour les investisseurs, tant nationaux qu’étrangers.
Si le gouvernement s’est mis en avant la modernisation des ports et la relance industrielle comme des piliers de la souveraineté économique, la réalité est bien plus contrastée. Les ports algériens souffrent d’un manque d’optimisation logistique, d’une gestion inefficace et de goulets d’étranglement administratif. L’Algérie est encore loin de concurrencer les hubs maritimes de la région, et sans réforme structurelle, elle risque de voir son potentiel inexploité. La transformation des ports en véritables hubs régionaux nécessite non seulement des investissements conséquents, mais aussi une refonte de la gestion, une transparence accrue et une meilleure intégration avec les chaînes logistiques internationales.
Concernant le secteur énergétique, les ambitions affichées de rationalisation de la consommation et de diversification restent largement théoriques. L’économie algérienne est toujours piégée dans une dépendance aux hydrocarbures, sans véritable plan de transition énergétique. Pendant ce temps, les subventions massives pèsent sur les finances publiques, retardant les réformes économiques nécessaires. Les tentatives de limiter le gaspillage énergétique sont louables, mais elles ne peuvent être efficaces sans une modernisation des infrastructures et une véritable politique de transition vers les énergies renouvelables.
Le secteur industriel, lui, continue d’accumuler des défis. La rigidité administrative, les obstacles au financement et l’absence de stratégies de développement freinent l’attractivité de l’Algérie pour les investisseurs. Les usines annoncées comme relancées doivent encore prouver leur viabilité, dans un contexte où beaucoup de promesses de réindustrialisation ont déjà échoué. Sans un assouplissement des procédures et une simplification des démarches pour les entreprises, il sera difficile d’attirer de nouveaux capitaux et d’assurer une croissance industrielle pérenne.
Si les annonces du président Tebboune traduisent une volonté apparente de transformation, leur mise en œuvre reste incertaine. La bureaucratie persistante, la corruption et l’absence de diversification économique compromettent la viabilité des réformes. L’annonce d’une augmentation des allocations pour les étudiants, bien que positive, ne répond pas aux revendications plus profondes sur la qualité de l’éducation et le manque de débouchés professionnels. L’enseignement supérieur algérien souffre d’un sous-investissement chronique et d’un manque d’adaptation aux besoins du marché du travail, ce qui limite les opportunités pour les jeunes diplômés.