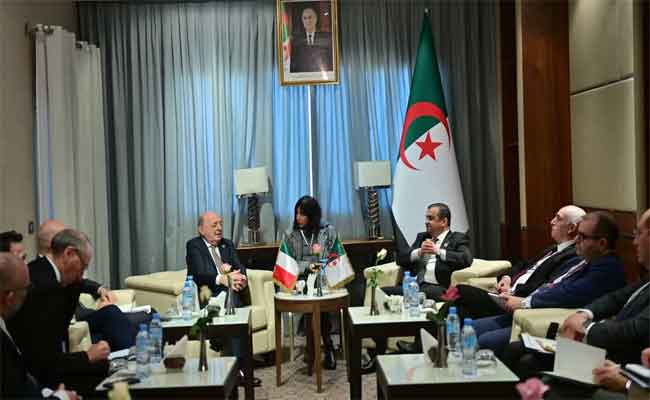L’économie algérienne dans le rouge : un déficit budgétaire en hausse face à la chute des prix du brut

La chute brutale des cours du pétrole sous la barre des 60 dollars le baril fragilise davantage les équilibres économiques déjà précaires de l’Algérie. Principal pilier des finances publiques, le secteur pétrolier continue de jouer un rôle déterminant dans le financement de l’économie nationale. Avec un baril de Brent tombé à 55,80 dollars et un WTI à 58,90 dollars, ces niveaux se situent bien en dessous du prix d’équilibre budgétaire estimé par les autorités algériennes, qui l’avaient fixé autour de 85 dollars. Chaque jour passé à ces prix défavorables ne fait qu’aggraver le déficit public, déjà estimé à plus de 10 % du PIB pour 2025.
La décision récente de l’OPEP+ d’augmenter la production de 411 000 barils par jour en juin, après une hausse équivalente en mai, ne fait qu’empirer la situation. En inondant le marché de pétrole supplémentaire, l’organisation exerce une pression supplémentaire sur les prix, sans que la demande mondiale ne suive cette augmentation d’offre. Une telle politique contribue à maintenir les prix bas, exacerbant les difficultés économiques du pays.
L’Algérie aborde cette crise économique sans filet de sécurité solide. Le Fonds de régulation des recettes est vide depuis 2017, et bien que les réserves de change aient légèrement augmenté ces dernières années, elles restent insuffisantes pour amortir un choc prolongé. Le gouvernement est désormais contraint de réduire ses dépenses publiques, de reporter certains projets d’investissement et d’augmenter son recours à l’endettement intérieur. Toutefois, ces mesures risquent de se heurter à une tension sociale croissante, dans un pays déjà marqué par un taux de chômage élevé et des inégalités régionales criantes.
Depuis janvier, plusieurs mouvements sociaux ont éclaté dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des transports, illustrant une exaspération croissante face à la stagnation du pouvoir d’achat. Le gouvernement, qui s’efforce de maintenir les subventions sur les produits de première nécessité, se trouve désormais à la croisée des chemins : réformer et risquer l’impopularité, ou maintenir un modèle coûteux et insoutenable à long terme. La question est d’autant plus pressante à l’approche de la présidentielle de 2026, où les tensions sociales pourraient atteindre un point de non-retour.
Les experts s’inquiètent de la montée des tensions à mesure que la crise économique s’intensifie. La perte des revenus pétroliers pourrait priver le régime d’une de ses principales armes de stabilisation sociale : l’argent public. Comme le souligne un ancien cadre du ministère des Finances, « l’Algérie paie aujourd’hui le prix de décennies de retard dans la réforme de son modèle économique ». Cette stagnation du secteur non pétrolier et l’absence de diversification de l’économie rendent le pays extrêmement vulnérable aux chocs externes.
Avec un marché pétrolier imprévisible et des finances publiques à bout de souffle, l’Algérie entre dans une zone de grande vulnérabilité. Sauf rebond spectaculaire des prix du pétrole — que peu d’analystes anticipent à court terme —, le pays devra faire des choix difficiles pour éviter une crise économique et sociale majeure.