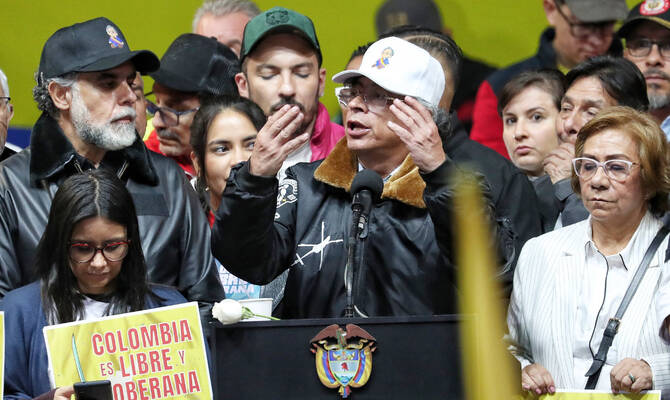Grèce : le projet de 13 heures de travail par jour fait scandale

La Grèce est secouée par un projet de réforme du gouvernement conservateur du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis qui prévoit d’instaurer une journée de travail pouvant atteindre 13 heures. Cette initiative, jugée « digne du Moyen Âge » par les syndicats et une large partie de l’opinion publique, s’inscrit dans un contexte déjà tendu : depuis juillet 2024, les travailleurs de l’industrie, du commerce de détail, de l’agriculture et de certains services peuvent être contraints de travailler six jours par semaine si leur employeur l’exige, avec une majoration salariale de 40 % pour le sixième jour.
Alors que l’Europe débat de la réduction du temps de travail – de la semaine de 4 jours en Espagne et au Royaume-Uni, aux expérimentations en Allemagne et en Belgique – la Grèce choisit le chemin inverse et polémique : légaliser des journées de travail interminables, rappelant une époque où les droits sociaux étaient inexistants.
Le texte, défendu par la ministre du Travail Niki Kerameos, permettrait aux salariés, sous certaines conditions et pour un maximum de 37 jours par an, de travailler 13 heures consécutives, en échange d’une rémunération majorée de 40 %. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis assume : « Nous offrons une liberté de choix, tant à l’employeur qu’au salarié. Pourquoi cela serait-il antisocial ? »
Mais pour les syndicats, la réalité est toute autre : dans un marché du travail précaire, où le chômage et les bas salaires frappent de plein fouet, refuser de telles conditions relèverait du luxe. « Ce n’est pas une liberté, mais un chantage déguisé », dénonce le syndicat PAME, qui fustige « l’esclavage moderne » que cherche à instaurer le gouvernement.
Selon Theodoros Koutroukis, professeur de relations de travail à l’Université Démocrite de Thrace, l’allongement des journées entraînera probablement une baisse de la satisfaction professionnelle et de la productivité des employés. La qualité des biens et services pourrait se détériorer, tandis que les coûts unitaires de la main-d’œuvre risquent d’augmenter.
L’expert ajoute que la journée prolongée affectera l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, limitant le temps que les travailleurs peuvent consacrer à leur formation et à leur développement personnel. Il recommande plutôt l’introduction d’heures supplémentaires ponctuelles et négociées collectivement, afin de répondre aux besoins exceptionnels de certains secteurs industriels ou de production.
Outre la semaine de travail de 13 heures, le projet prévoit des horaires flexibles, une répartition adaptable des jours de congés, et la possibilité d’ajouter jusqu’à 120 minutes supplémentaires par jour via une application. Une semaine de quatre jours pour 40 heures reste également envisageable.
Si la ministre Kerameos défend la réforme comme une « adaptation à la réalité du travail », les experts y voient surtout une légalisation des abus déjà constatés dans le passé, une manière de formaliser des pratiques qui étaient jusqu’ici tolérées mais contestables.
La confédération syndicale grecque GSEE rejette en bloc la réforme : « L’épuisement n’est pas synonyme de reprise économique ; la résilience humaine a ses limites », martèlent les manifestants. Le syndicat réclame une réduction de la semaine de travail à 37,5 heures, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays européens.