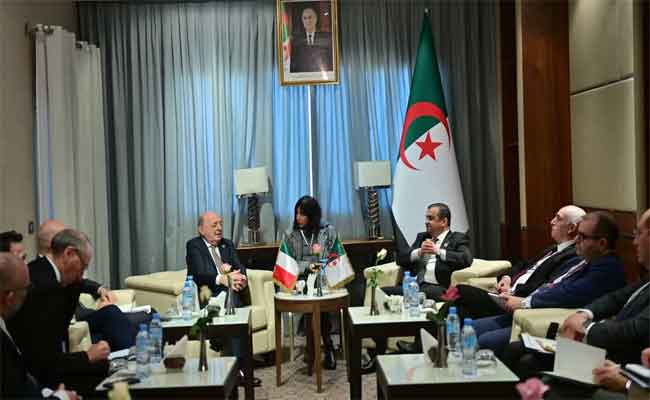Algérie : La Dette Extérieure, Révélatrice d’une Économie au Bord du Gouffre

Le président Abdelmadjid Tebboune a fait de la dénonciation de l’endettement extérieur un pilier de son discours souverainiste. En 2021, il affirmait que l’Algérie n’aurait jamais recours aux financements étrangers pour préserver ses positions diplomatiques. Pourtant, la sollicitation d’un prêt de 3 milliards de dollars auprès de la Banque islamique de développement (BID) pour un projet ferroviaire contredit cette posture. Cette démarche, suspendue à l’approbation de pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – avec lesquels les relations sont tendues – révèle une diplomatie erratique et une dépendance croissante envers des partenaires critiqués publiquement.
Classée à haut risque par les prêteurs internationaux, l’Algérie souffre d’une économie mono-dépendante des hydrocarbures, qui représentent plus de 90 % des exportations. La chute des prix du pétrole de plus de 20 % depuis janvier 2025 creuse un déficit budgétaire record, tandis que les réserves de change s’épuisent. Au lieu de réformes structurelles, le régime opte pour des expédients destructeurs : restrictions sur les importations, expansion monétaire incontrôlée et manipulation du PIB par l’intégration du secteur informel. Ces subterfuges aggravent la fragilité économique et alimentent l’inflation.
Les économistes soulignent que la dette extérieure, bien gérée, pourrait financer des investissements productifs dans les énergies renouvelables, l’agriculture ou les technologies. Mais le régime, obsédé par une stabilité sociale illusoire, dilapide ses ressources dans des subventions massives, sacrifiant la viabilité financière. Ce refus des réformes, motivé par la peur de perdre le contrôle, condamne l’Algérie à une dépendance chronique aux fluctuations pétrolières et à une instabilité croissante.
La sollicitation du prêt auprès de la BID, dans un contexte de relations diplomatiques conflictuelles, place l’Algérie en position de faiblesse. Les prêteurs imposeront des conditions draconiennes, sapant davantage la crédibilité d’un régime qui oscille entre slogans nationalistes et compromissions humiliantes. Cette incohérence fait de l’Algérie un acteur marginalisé sur la scène internationale, incapable de peser dans les rapports de force régionaux.
Le peuple algérien subit les conséquences d’une gestion calamiteuse : chômage massif (plus de 30 % chez les jeunes), inflation galopante, fuite des cerveaux, infrastructures délabrées et menace d’un endettement opaque. Le Hirak de 2019 avait porté les espoirs d’un changement, mais le régime, retranché dans son autoritarisme, continue de trahir ces aspirations, condamnant le pays à un avenir incertain.