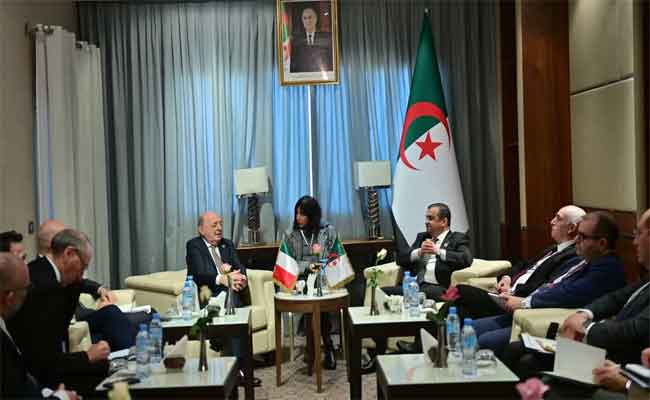Économie algérienne en détresse : des réformes déconnectées face à une balance des paiements en chute libre

La situation économique de l’Algérie se détériore à nouveau en 2025, et sa balance des paiements replonge dans le rouge, avec un déficit pouvant dépasser 10 milliards de dollars d’ici décembre, selon les projections internationales et les données partielles de la Banque d’Algérie. Ce constat n’a rien de surprenant, l’économie, dépendante des hydrocarbures, subit de plein fouet les chocs externes. Face à cette hémorragie, le ministre du commerce extérieur, Kamel Rezig, déploie une artillerie lourde, contrôles administratifs stricts, verrouillage des importations, exigences bancaires étouffantes.
Les opérateurs économiques crient au scandale, dénonçant une réponse brutale et déconnectée des réalités du terrain. Cette crise n’est pas nouvelle ; elle s’inscrit dans un cycle infernal qui met en lumière, une fois encore, l’incapacité de l’État à rompre sa dépendance au pétrole.
Les crises se suivent et se ressemblent. Depuis le plan d’ajustement du FMI en 1995, l’Algérie navigue de tempête en tempête. En 1998-1999, le baril s’effondre à 10 dollars, mettant à nu des réserves fragiles. En 2009, la crise des subprimes fait chuter le pétrole à 32 dollars, creusant un déficit de 6 milliards de dollars. Le gouvernement d’Ahmed Ouyahia riposte alors par des mesures défensives : restrictions sur les importations, encadrement des IDE, crédits documentaires obligatoires. Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) fustige une approche inflationniste. En 2015-2016, le choc est plus rude : 27 milliards de dollars de déficit en 2015, 26 milliards en 2016. Abdelmalek Sellal tente une stratégie mixte : austérité budgétaire, dépréciation du dinar, restrictions commerciales et débat national. Ces crises, loin d’être des accidents, révèlent un mal profond : une économie incapable de se réinventer.
Comparer les réponses de 2009, 2015-2016 et 2025 permet de mesurer l’érosion de la vision stratégique. En 2009, des réserves de 140 milliards de dollars offraient un coussin confortable. L’État misait sur des restrictions ciblées, préservant les dépenses sociales pour maintenir la paix sociale. En 2015-2016, face à des déficits colossaux, Sellal diversifie l’approche : austérité, ajustement monétaire, débat public. En 2025, la réponse de Rezig marque un retour en arrière : quotas, interdictions, déclarations anticipées — tout repose sur une compression brutale des importations. Aucune réforme budgétaire n’est envisagée, aucune remise en cause des subventions, aucune stratégie de diversification des exportations, malgré des discours emphatiques. Ce choix unilatéral trahit un État à bout de souffle, incapable d’imaginer une sortie de crise durable.
Cette gestion à courte vue menace l’avenir. Avec un déficit projeté entre 10 et 15 milliards de dollars — inférieur à celui de 2015 — l’Algérie aurait pu saisir l’occasion pour réformer. Au lieu de cela, elle s’enferre dans des mesures bureaucratiques qui étouffent le tissu économique. Les réserves de change s’épuisent pour combler les trous, les transferts sociaux restent intacts, et le dinar, déprécié sur le marché parallèle, demeure figé dans les chiffres officiels. Les investisseurs, déjà méfiants, se détournent. Les entreprises, asphyxiées par les restrictions, peinent à produire. Cette approche ne résout rien : elle reporte l’inévitable, au risque d’un effondrement social et économique. L’Algérie doit-elle attendre un choc encore plus grave pour agir ?