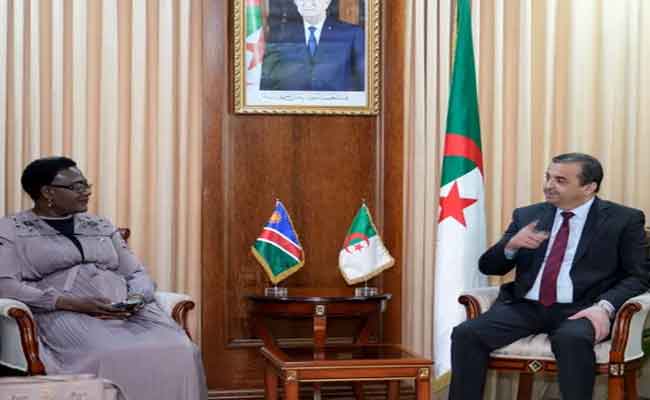Les rumeurs d’augmentation de la production de l’OPEP+ s’inversent : vers quelle direction les prix du pétrole ?

Les prix du pétrole poursuivent leur chute, confirmant la fébrilité d’un marché constamment soumis aux manœuvres diplomatiques et aux calculs stratégiques de l’OPEP+. Mardi, le Brent de la mer du Nord reculait de 44 cents, soit 0,65 %, à 67,53 dollars le baril, tandis que le contrat le plus actif pour livraison en décembre cédait 53 cents, soit 0,8 %, à 66,56 dollars. De son côté, le WTI américain a perdu 39 cents (0,61 %) à 63,60 dollars, les contrats de décembre chutant de 50 cents (0,8 %) à 62,95 dollars. Ces pertes s’ajoutent à la correction brutale de lundi, lorsque les deux indices avaient enregistré une baisse de plus de 3 %, la plus importante depuis le 1er août.
Derrière cette nouvelle glissade se cachent deux facteurs structurants : la reprise inattendue des exportations de brut du Kurdistan irakien via la Turquie, après plus de deux ans d’interruption, et la perspective d’une révision de la politique de l’OPEP+. Selon l’analyste d’IG Tony Sycamore, « les prix du pétrole ont chuté suite à la reprise des exportations kurdes et aux informations selon lesquelles les huit membres de l’alliance pourraient décider d’annuler une autre partie de leurs réductions volontaires de l’offre dès novembre ».
Cette hypothèse illustre une fois de plus les contradictions internes de l’OPEP+. Créée en 2016 pour stabiliser les prix et protéger les revenus des producteurs, l’alliance peine aujourd’hui à contenir les divergences entre ses membres. D’un côté, l’Arabie saoudite, qui continue de jouer le rôle de régulateur en ajustant sa production selon ses propres impératifs budgétaires et géopolitiques ; de l’autre, des partenaires comme la Russie, l’Irak ou l’Iran, plus enclins à maximiser leurs exportations malgré les quotas.
Le retour du brut kurde, suspendu depuis mars 2023 pour des raisons politiques et juridiques, accentue encore la pression baissière. À cela s’ajoute la reprise progressive de la production libyenne et iranienne, qui alimente la crainte d’un excédent structurel sur un marché déjà miné par la faiblesse de la demande mondiale.
Pour les économies rentières comme l’Algérie, ce scénario est inquiétant : chaque dollar perdu sur le baril fragilise un peu plus des finances publiques déjà sous tension, entièrement dépendantes des recettes d’hydrocarbures. La dépendance chronique au pétrole expose le pays à une volatilité que ni les réformes structurelles, ni la diversification économique tant annoncée n’ont su atténuer.
Derrière la mécanique des prix, c’est donc un enjeu plus profond qui se joue : la capacité réelle de l’OPEP+ à rester un acteur stabilisateur dans un marché où les alliances sont fragiles, les équilibres changeants et où chaque baril supplémentaire devient un instrument de puissance autant qu’une menace pour ses propres membres.