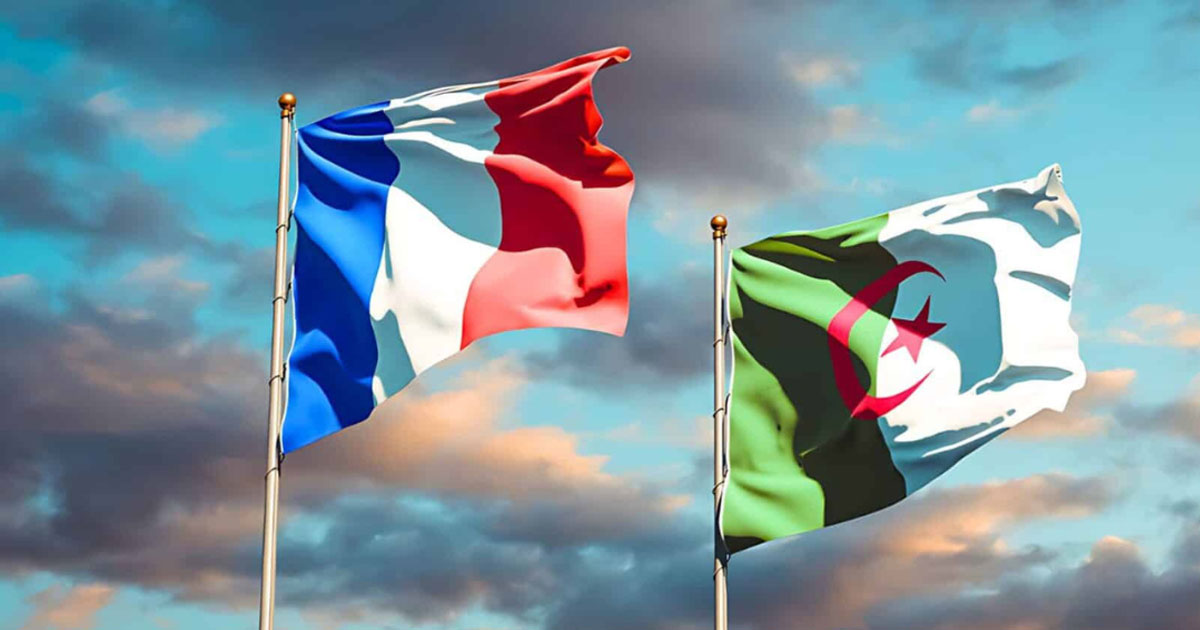La réaction de l’Algérie face à la nouvelle démarche française sur les éloignements de ressortissants algériens relève davantage d’un réflexe d’opposition systématique que d’une défense cohérente de ses intérêts. À peine Paris a-t-il transmis une liste de personnes sous le coup d’une expulsion que le gouvernement algérien s’est empressé de rejeter cette approche, sous couvert de principes juridiques discutables, tandis que le ministre de l’Intérieur français, Bruno Retailleau, dénonçait une nouvelle fois le non-respect par Alger de ses engagements internationaux.
L’attitude algérienne repose sur une série d’arguties juridiques visant à masquer une absence totale de volonté de coopérer sur une question pourtant régie par des accords bilatéraux et par le droit international. En rejetant d’emblée la transmission de ces listes, l’Algérie ne fait que perpétuer une politique d’obstruction qui empêche toute gestion rationnelle des flux migratoires. L’argument selon lequel cette procédure n’est pas explicitement prévue par les accords en vigueur est un écran de fumée : en pratique, la coopération entre États repose sur une souplesse et une adaptation aux réalités du moment, pas sur un formalisme rigide servant d’excuse pour se soustraire à ses responsabilités.
Pire encore, Alger tente de renverser la charge de la faute en accusant Paris d’unilatéralisme et de menaces, alors que la France ne fait que rappeler ses droits souverains à réguler son territoire. Il est tout à fait légitime pour un État d’exiger le respect des procédures d’éloignement et d’attendre de son partenaire qu’il facilite l’identification et la réadmission de ses propres ressortissants.
Le cœur du problème réside dans la question de la protection consulaire, que l’Algérie brandit comme un rempart contre toute décision d’éloignement. En réalité, ce principe ne saurait être invoqué pour entraver l’application des décisions administratives françaises. L’accord consulaire de 1974, cité opportunément par Alger, prévoit certes des obligations de notification, mais il ne saurait justifier un refus systématique d’octroyer les laissez-passer consulaires indispensables aux expulsions. À ce jeu, l’Algérie ne défend pas ses citoyens, elle les instrumentalise pour compliquer la tâche des autorités françaises.
L’un des points les plus révélateurs de cette mauvaise foi algérienne est l’argument avancé sur la Convention de Chicago et le rôle d’Air Algérie. La compagnie nationale algérienne aurait, selon Alger, toute latitude pour refuser l’embarquement de passagers sous prétexte que leurs documents ne seraient pas conformes. Or, cette lecture délibérément biaisée de la Convention omet un élément fondamental : ces documents sont délivrés par l’Algérie elle-même. En refusant d’émettre les laissez-passer nécessaires, Alger s’arroge un droit de veto sur des décisions d’expulsion légitimes, en violation flagrante des pratiques internationales.
Enfin, les mesures restrictives prises à l’égard des détenteurs de passeports diplomatiques algériens et la possible suspension de l’accord de 2013 illustrent une nouvelle fois la volonté française de répondre à l’intransigeance algérienne. Si Paris décide de revoir ces facilités, c’est en réaction à une obstruction persistante. Là encore, Alger crie à la violation des engagements bilatéraux tout en feignant d’ignorer qu’une coopération repose sur la réciprocité.
Au final, ce bras de fer illustre un refus constant de l’Algérie de reconnaître ses obligations internationales. Accuser la France de manquement aux accords alors que c’est elle-même qui torpille tout mécanisme de coopération relève d’un renversement accusatoire absurde. Si un État viole ses engagements de manière flagrante et systématique, ce n’est certainement pas la France.