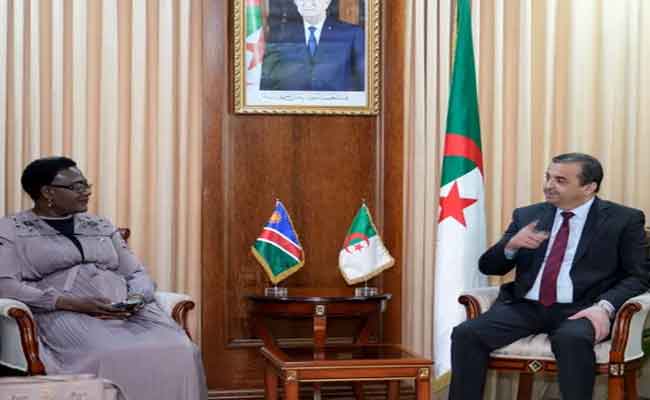Hausse de la production pétrolière : Quel sera l’impact de la nouvelle décision des pays de l’OPEP+ sur l’Algérie ?

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+), qui contrôlent près de la moitié de la production mondiale, tiendront une réunion en ligne le 5 octobre afin de décider des niveaux de production pour novembre. Selon plusieurs sources, une augmentation d’au moins 137 000 barils par jour devrait être approuvée. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à regagner des parts de marché, après plusieurs mois de hausse des prix qui avaient dépassé le seuil symbolique des 70 dollars le baril.
Depuis avril, l’OPEP+ a inversé sa politique de réduction, augmentant sa production de plus de 2,5 millions de barils par jour, soit environ 2,4 % de la demande mondiale. Cette initiative répond notamment à la pression des États-Unis, soucieux de contenir les prix de l’énergie. Le marché pétrolier évolue désormais dans une fourchette de 60 à 70 dollars le baril, après avoir atteint plus de 80 dollars en début d’année.
Pour l’Algérie, membre fondateur de l’OPEP, la décision de l’organisation est à double tranchant. À court terme, une augmentation de la production mondiale pourrait faire baisser les prix et donc réduire les revenus pétroliers du pays, lesquels dépendent encore à plus de 90 % des hydrocarbures pour leurs recettes d’exportation.
À moyen terme, Alger pourrait néanmoins tirer parti de quotas légèrement relevés, lui permettant d’accroître son offre et de préserver sa place sur le marché. Mais cette perspective reste limitée par un manque chronique d’investissements, une infrastructure énergétique vieillissante et des retards persistants dans la modernisation du secteur.
Cette équation est d’autant plus complexe que la baisse récente des prix s’explique par une série de facteurs combinés : les attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes perturbent temporairement l’offre de Moscou ; parallèlement, le retour progressif du pétrole kurde sur le marché via la Turquie accentue la pression à la baisse ; enfin, les sanctions internationales contre l’Iran entretiennent les incertitudes au Moyen-Orient.
Pris ensemble, ces éléments nourrissent une volatilité permanente : les prix peuvent chuter sous l’effet d’une offre excédentaire, mais aussi rebondir brutalement au gré des tensions géopolitiques.
Si les cours du Brent se stabilisent autour de 65 à 70 dollars, l’Algérie conservera un niveau de recettes jugé « acceptable », bien que très inférieur aux besoins budgétaires réels pour financer ses dépenses publiques et sociales. En revanche, une chute durable en dessous de 60 dollars pourrait fragiliser sérieusement les équilibres financiers du pays, déjà sous tension.
Pour l’heure, les autorités algériennes observent avec attention les débats au sein de l’OPEP+, espérant un compromis conciliant stabilité des prix et hausse mesurée de la production. Mais cette posture révèle surtout une vulnérabilité structurelle : l’économie algérienne reste prisonnière d’un modèle rentier, incapable de se diversifier, et chaque fluctuation des cours du brut agit comme un séisme budgétaire. Dans un marché mondial en recomposition, cette dépendance chronique aux hydrocarbures souligne plus que jamais les limites de la stratégie d’Alger.