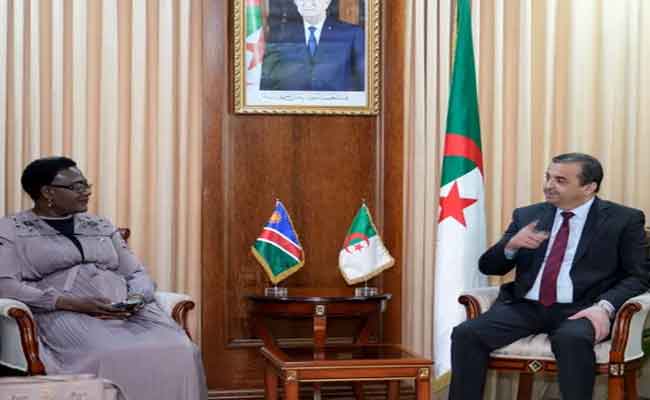Le marché réagit aux stocks américains et aux sanctions russes, les prix internationaux du pétrole augmentent

Les marchés pétroliers ont repris des couleurs mercredi, soutenus par une baisse surprise des stocks américains et les tensions persistantes liées aux sanctions occidentales contre les principaux producteurs russes. Cette dynamique a entraîné une hausse des prix internationaux du pétrole, mettant fin à trois jours de recul.
Le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en décembre sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) a gagné 0,6 % pour clôturer à 60,48 dollars le baril. De son côté, le Brent de Londres pour livraison en décembre a progressé de 0,8 %, terminant à 64,92 dollars le baril. Cette évolution, contraire aux prévisions des analystes, ravive l’espoir d’une demande plus soutenue à l’approche de l’hiver, dans un contexte où les tensions géopolitiques et commerciales continuent d’influencer l’offre globale.
Pour la semaine se terminant le 24 octobre 2025, les stocks américains de brut ont chuté de 6,9 millions de barils, totalisant environ 416 millions de barils. Les experts interrogés par Bloomberg anticipaient au contraire une augmentation de plus de 1,2 million de barils, ce qui aurait signalé une offre excédentaire persistante. Cette baisse inattendue, confirmée par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) dans son rapport du 29 octobre, reflète une absorption plus rapide par les raffineries, avec des entrées en usine en hausse à 15,7 millions de barils par jour. Les importations ont reculé de 393 000 barils par jour, tandis que la production domestique reste robuste à 13,5 millions de barils par jour.
Cette dynamique traduit une demande plus vigoureuse que prévu, portée par la reprise économique aux États-Unis et en Europe, où les besoins en carburant pour le chauffage et les transports se font sentir. Les stocks de produits distillés, comme le diesel, ont également diminué de 2,1 millions de barils, confirmant l’idée d’une consommation accrue. À l’inverse, les réserves d’essence ont légèrement augmenté (+1,2 million de barils), un mouvement marginal face à la tendance baissière générale. Au total, les inventaires commerciaux américains se situent désormais 4 % en dessous de la moyenne quinquennale pour cette période, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis le pic post-pandémique de 2021.
.Ces chiffres tempèrent les craintes d’un excédent structurel, exacerbées par les décisions de l’OPEP+ visant à ajuster progressivement ses quotas. Depuis avril 2025, huit pays clés – dont l’Arabie saoudite, la Russie, l’Irak et les Émirats arabes unis – augmentent leur production de 138 000 barils par jour chaque mois, dans le cadre d’un plan visant à restituer 2,2 millions de barils par jour de coupes volontaires mises en place en 2023. En mai, l’ajustement a été accéléré à 411 000 barils par jour, en réponse aux surproductions passées de certains membres. Résultat : la production globale de l’OPEP+ a stagné à 26,98 millions de barils par jour en avril, malgré ces hausses théoriques, en raison de compensations internes. Cette politique flexible pourrait être suspendue si les prix venaient à tomber sous 60 dollars, illustrant la volonté du groupe d’équilibrer le marché sans provoquer de surchauffe inflationniste.
Toutefois, l’EIA prévoit une accumulation d’inventaires mondiaux jusqu’en 2026, pouvant tirer les prix vers le bas , le Brent pourrait ainsi retomber à 62 dollars au quatrième trimestre 2025, et même à 52 dollars l’an prochain, en raison de la hausse attendue de la production non-OPEP de 2 millions de barils par jour. Les tensions au Moyen-Orient, notamment les perturbations dans le détroit d’Ormuz et les sanctions contre le Venezuela, continuent d’ajouter une prime de risque géopolitique estimée à 5 dollars par baril.
Côté demande, la transition énergétique freine la croissance mondiale, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit un pic de consommation mondiale dès 2028, avec une part croissante des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Parallèlement, les investisseurs suivent de près la rencontre imminente entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, prévue le 30 octobre à Busan en Corée du Sud, lors du sommet APEC. Les marchés attendent un éventuel accord commercial bilatéral, susceptible d’éviter une escalade tarifaire qui pèserait sur la croissance mondiale et, par ricochet, sur la demande pétrolière.