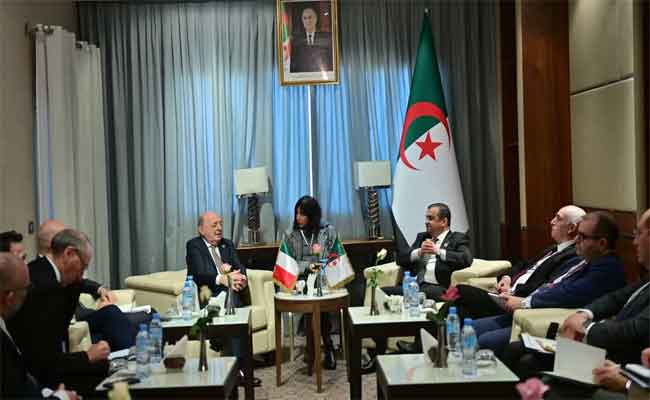Marchés pétroliers en recul : Semaine noire, tarifs douaniers, géopolitique et échec de l’OPEP+ plombent les cours

Les marchés pétroliers traversent une semaine noire. Les cours du brut s’orientent vers leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, pris dans une tourmente où se mêlent tensions commerciales, revirement stratégique de l’OPEP+, incertitudes géopolitiques et ralentissement de la demande mondiale. Alors que les investisseurs tentent de lire entre les lignes d’une actualité économique et diplomatique de plus en plus complexe, les prix du Brent et du WTI s’effondrent sous la pression conjuguée des facteurs structurels et conjoncturels.
À l’ouverture des marchés asiatiques vendredi, le Brent s’échangeait à 66,40 dollars le baril, en baisse de plus de 4 % sur la semaine. De son côté, le WTI chutait à 63,82 dollars, enregistrant une dégringolade de près de 5 %, marquant une sixième séance consécutive dans le rouge — une série inédite depuis décembre 2023.
La chute s’est accentuée avec l’entrée en vigueur, jeudi, de nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis, notamment sur les importations indiennes, en représailles aux achats de pétrole brut russe. Ces sanctions, initiées par l’administration Trump, soulèvent la crainte d’un retour à une guerre commerciale globale, menaçant la croissance mondiale, et donc la demande en énergie.
L’Inde et la Chine, premiers acheteurs de pétrole russe, sont dans la ligne de mire de Washington. Selon plusieurs analystes, cette posture agressive pourrait créer une instabilité durable dans les flux mondiaux de pétrole. Bien que certains raffineurs indiens aient rapidement réagi en se tournant vers des sources alternatives (plus de 22 millions de barils déjà achetés hors Russie), l’impact psychologique sur les marchés reste fort.
Le Kremlin a confirmé jeudi qu’une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine aurait lieu dans les prochains jours. Si certains y voient un espoir de sortie diplomatique au conflit en Ukraine, d’autres redoutent au contraire un renforcement des sanctions économiques en cas d’impasse.
Les marchés pétroliers, toujours très sensibles aux signaux politiques, ont interprété cette annonce comme un facteur d’incertitude supplémentaire. D’autant que Trump a lié ces discussions à une échéance : la fin de l’ultimatum américain pour un accord de paix, posant le risque d’un durcissement immédiat des sanctions si aucun progrès n’est observé.
Autre facteur aggravant , l’annonce surprise de l’OPEP+ de lever plus tôt que prévu la plus grande tranche de ses coupes de production à partir de septembre. Une décision qui a été perçue comme un aveu de faiblesse face à la pression économique, et non comme une mesure maîtrisée de régulation du marché.
Mais le retour de cette production ne s’est pas effectué aussi vite qu’annoncé, révélant des divisions internes et une capacité d’ajustement limitée au sein du cartel. Ce flottement stratégique a accentué le sentiment baissier parmi les traders, déjà méfiants vis-à-vis d’une offre potentiellement excédentaire.
Seul élément potentiellement haussier, les importations chinoises de pétrole, qui ont augmenté de 11,5 % en juillet sur un an. Cependant, cette hausse cache une baisse mensuelle par rapport à juin, mois où Pékin avait massivement importé à prix réduit. Le rebond chinois apparaît donc t insuffisant pour compenser la nervosité ambiante.