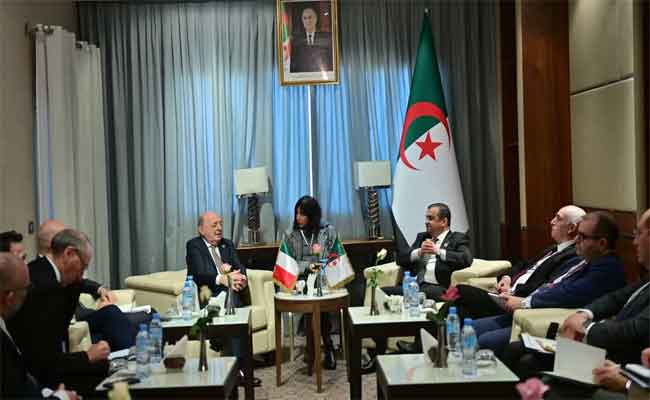L’Algérie face à un déclassement économique : une alerte pour une réforme radicale

L’Algérie assiste, impuissante, à une dégringolade économique silencieuse mais brutale. Selon les récentes estimations de l’Agence nationale d’orientation nigériane (NOA), relayées par The Explainer, le Nigeria devrait supplanter l’Algérie dès 2025 en tant que troisième puissance économique d’Afrique. Ce n’est pas qu’un simple jeu de chiffres : c’est le reflet d’un effondrement structurel et d’un échec de gouvernance économique persistant.
Alors que le Nigeria, pourtant confronté à des défis colossaux – insécurité, inflation, instabilité monétaire – parvient à tirer parti de la vitalité de son économie informelle, de l’innovation numérique et de la diversification sectorielle, l’Algérie s’enlise dans son dogme rentier. Le pétrole et le gaz représentent encore plus de 90 % des exportations et 60 % du budget de l’État, exposant le pays à chaque choc pétrolier comme à un tsunami budgétaire. Pendant ce temps, le Nigeria, grâce à une réévaluation de son PIB nominal à 243,7 milliards de dollars (contre 247,6 milliards pour l’Algérie), et une croissance réelle cumulée de 81,8 % entre 2019 et 2024, consolide une économie résiliente et tournée vers l’avenir.
Ce déclassement illustre un mal bien plus profond : l’immobilisme institutionnel algérien. Malgré une jeunesse nombreuse, une position géographique stratégique, et d’immenses ressources naturelles, l’Algérie reste prisonnière d’une économie figée, dominée par une bureaucratie étouffante, une législation rigide, un climat des affaires dissuasif, et un appareil productif déserté.
Depuis deux décennies, les discours de réforme se succèdent mais ne produisent que de la poudre aux yeux. L’entrepreneuriat est étouffé, l’investissement privé marginalisé, et l’investissement étranger, vital pour tout développement moderne, se détourne. En 2024, le pays ne se classe que 91e au FM Resilience Index, loin derrière ses voisins immédiats.
Certes, l’Algérie a enregistré 5,1 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures en 2023, principalement dans l’agriculture. Mais cette embellie reste superficielle : 45 % des besoins alimentaires sont encore importés, mettant à mal les réserves de change et révélant l’insuffisance des politiques de souveraineté alimentaire.
Le numérique, la transition verte, les énergies renouvelables, les services – tous les moteurs de croissance du XXIe siècle – sont absents de la stratégie économique algérienne. Pire encore, la fuite des cerveaux s’accélère, vidant le pays de son capital humain le plus dynamique. Des milliers de jeunes formés, diplômés, innovants, préfèrent tenter leur chance à l’étranger, abandonnant un système qui les marginalise.
L’Algérie n’est pas victime d’un complot international ni d’un désordre mondial injuste. Elle est victime de son incapacité chronique à se réformer. Là où d’autres pays africains prennent des risques, innovent, investissent dans l’éducation, la transition énergétique ou les technologies émergentes, Alger reste figée dans une économie d’hier, arc-boutée sur des recettes obsolètes.
L’illusion que les hydrocarbures suffiront à éternellement financer le contrat social s’effondre. Les recettes pétrolières ne peuvent plus masquer l’absence d’une vision industrielle, la fragilité de l’appareil productif et l’érosion du lien entre les jeunes générations et leur avenir national.
Le déclassement annoncé au profit du Nigeria doit agir comme une gifle stratégique. Il n’est plus temps de tergiverser. L’Algérie doit choisir entre une réforme économique radicale et courageuse ou l’effacement progressif de la scène continentale.
Car l’enjeu n’est pas seulement économique. Il est aussi social, politique, et existentiel. Une nation sans vision est une nation en déclin. Et aujourd’hui, c’est tout l’avenir algérien qui vacille.