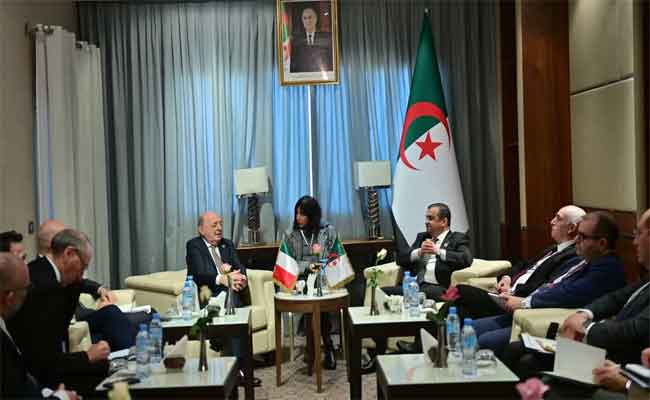Accord bafoué, économie menacée : l’UE traduit l’Algérie en justice internationale et exige des comptes

Bruxelles, 18 juillet 2025 – L’Union européenne (UE) brandit l’arme de l’arbitrage international contre l’Algérie, accusée de violer de manière systématique l’accord d’association de 2002, en vigueur depuis 2005. Lancée le 15 juillet 2025, cette procédure, activée après l’échec des pourparlers de juin 2024, cible un arsenal de restrictions commerciales et d’obstacles aux investissements jugés « discriminatoires » et « contraires aux engagements contractuels ». Ce bras de fer, d’une gravité inédite, menace de fracturer les relations économiques entre Alger et son principal partenaire commercial.
La Commission européenne dresse un réquisitoire implacable contre les pratiques économiques algériennes, instaurées progressivement depuis 2021, accusées de bafouer les principes fondamentaux de libre-échange inscrits dans l’accord d’association.
Bruxelles dénonce un arsenal de mesures protectionnistes qui, sous couvert de souveraineté économique, se traduisent par une fermeture de facto du marché algérien aux entreprises européennes. Au cœur de ce dispositif : un système de licences d’importation rigide, orchestré via la plateforme ALGEX, qui impose des autorisations préalables pour chaque transaction, souvent délivrées de manière opaque et arbitraire, équivalant à une barrière non tarifaire dissimulée.
Cette logique de restriction s’étend à des moratoires catégoriques sur des biens stratégiques – véhicules neufs, marbre, céramique – sans qu’aucune alternative industrielle locale ne vienne justifier ces interdictions, plongeant le marché intérieur dans des pénuries structurelles. De plus, la persistance de la règle du 51/49, officiellement allégée mais toujours appliquée de manière erratique et discrétionnaire, empêche toute visibilité pour les investisseurs étrangers.
À cela s’ajoute un environnement administratif chaotique, fait de réenregistrements incessants, de blocages douaniers imprévisibles et d’instabilité réglementaire chronique, qui engendrent une insécurité juridique décourageante. Enfin, la politique de substitution aux importations, plutôt que de dynamiser l’appareil productif, désorganise les chaînes d’approvisionnement, renforçant la dépendance au marché informel et détournant l’objectif initial d’autonomie industrielle. Autant de facteurs qui, selon l’UE, dénaturent l’esprit même du partenariat euro-algérien et justifient aujourd’hui le recours à l’arbitrage international.
Ces mesures ont laminé les exportations européennes, en chute libre de 31 % entre 2014 (24,6 milliards d’euros) et 2024 (17 milliards d’euros). Alors que l’UE absorbe 60 % des échanges extérieurs algériens, principalement via les hydrocarbures, Bruxelles dénonce un traitement « hostile » et un ciblage délibéré des entreprises françaises et espagnoles
Pour Bruxelles, ces pratiques relèvent d’une instrumentalisation du commerce à des fins politiques, violant les principes de non-discrimination de l’accord d’association. Alger, de son côté, revendique une « souveraineté économique » pour juguler la fuite de ses réserves de change, en berne face à une dépendance chronique aux hydrocarbures (95 % des recettes d’exportation). Pourtant, l’interdiction de biens non produits localement, comme les véhicules, alimente un marché noir et une inflation galopante, au détriment des consommateurs algériens.
Face à l’impasse des négociations, l’UE a désigné un arbitre et enjoint l’Algérie à nommer le sien sous deux mois. Un troisième arbitre, choisi par le Conseil d’association UE-Algérie, garantira la neutralité du tribunal, dont la décision sera contraignante. Bruxelles reste ouverte à un règlement amiable, mais exige la levée des restrictions, notamment celles visant les opérateurs français.
Une issue défavorable pour Alger pourrait ouvrir la voie à des sanctions commerciales ou à une suspension partielle de l’accord d’association, un scénario aux conséquences graves pour une économie dépendante des exportations énergétiques vers l’Europe. D’autant que, dès le 1er août 2025, une surtaxe américaine de 30 % sur certains produits algériens accentuera la pression.
L’Algérie, sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, campe sur une posture souverainiste, réclamant une renégociation de l’accord. Mais l’absence de clarté sur des règles comme le 51/49 et les lourdeurs administratives découragent les investisseurs, freinant la diversification économique.
Des réformes récentes, comme le nouveau code de l’investissement, laissent entrevoir une volonté de modernisation, mais leur mise en œuvre reste entravée par des réflexes protectionnistes. Un compromis, impliquant un assouplissement des restrictions algériennes et une reconnaissance par l’UE des aspirations souverainistes d’Alger, pourrait désamorcer la crise. À défaut, cet arbitrage pourrait marquer un tournant vers une fracture économique durable, redessinant les rapports de force en Méditerranée.