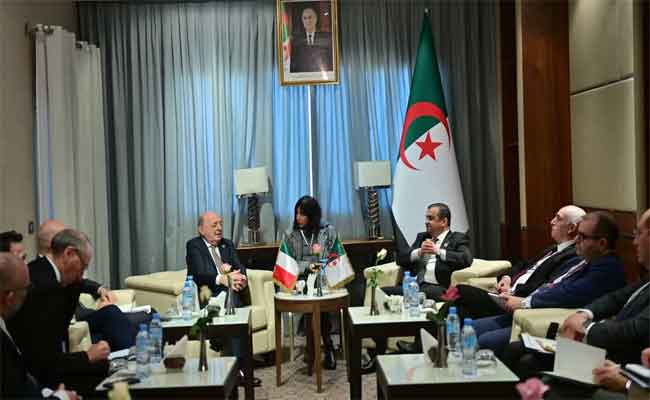Les tarifs douaniers américains frappent l’Afrique : l’Algérie et la Libye en première ligne avec les taux les plus élevés

Récemment, les relations commerciales entre les États-Unis et plusieurs pays africains ont atteint un niveau inédit de tension. Le président Donald Trump a officiellement annoncé un durcissement des mesures tarifaires à l’encontre de certains pays africains, parmi lesquels figurent l’Algérie et la Libye. Ces pays se voient désormais imposer des droits de douane dits « réciproqués », une mesure protectionniste visant à sanctionner ce que Washington qualifie de déséquilibres commerciaux persistants et d’un manque de coopération lors des négociations bilatérales..
Initialement programmés pour entrer en vigueur le 1er août, ces droits de douane ont bénéficié d’un sursis technique jusqu’au 7 août, afin de permettre une révision administrative du code tarifaire américain. Toutefois, leur application demeure inéluctable en l’absence d’un accord commercial satisfaisant. L’Algérie et la Libye, en particulier, sont frappées par le taux le plus élevé imposé sur le continent, atteignant 30 %, bien au-delà du seuil de base de 10 % instauré par les « Liberation Day Tariffs » d’avril 2025.
Si l’impact économique direct des échanges algéro-américains demeure limité en volume, cette sanction douanière inflige à l’Algérie un revers symbolique majeur. Sont concernées notamment les exportations d’engrais, produits chimiques, dérivés pétrochimiques et biens industriels, filières que le gouvernement cherche à valoriser pour sortir d’une dépendance chronique aux hydrocarbures.
Or, à l’inverse de l’Afrique du Sud — qui a multiplié les propositions pour éviter la sanction — l’Algérie est restée en retrait des discussions, sans initiative diplomatique notable, révélant une carence de stratégie commerciale face aux grandes puissances. L’absence de contre-proposition avant la date butoir du 1er août a de facto ouvert la voie à ces droits de douane punitifs.
« L’Algérie paie aujourd’hui son absence d’ancrage dans les négociations commerciales multilatérales », souligne un analyste du commerce international à Rabat.
Également visée par le taux maximal de 30 %, la Libye, encore en phase de reconstruction, est une autre victime de ce tournant protectionniste. Ses exportations, principalement centrées sur les matières premières énergétiques, seront désormais lourdement taxées, ce qui pourrait ralentir les quelques partenariats en cours avec des groupes pétroliers américains et européens.
Dans un contexte de fragilité institutionnelle, cette mesure tarifaire renforce l’isolement économique de Tripoli et fragilise davantage ses perspectives de stabilité.
Au total, plus d’une vingtaine de pays africains sont concernés, mais seuls l’Algérie, la Libye et l’Afrique du Sud atteignent le seuil symbolique des 30 %. Des pays comme la Tunisie (25 %), le Nigeria (15 %), ou encore le Lesotho (initialement menacé de 50 %, abaissé à 15 %) ont eux aussi été frappés, mais de manière moins sévère. Les tarifs douaniers américains pèsent lourdement sur une économie algérienne déjà confrontée à de nombreux défis. En premier lieu, les secteurs non liés aux hydrocarbures, encore émergents et en pleine phase de développement, risquent d’être dissuadés d’exporter vers les États-Unis. La hausse des droits de douane augmente en effet le coût des produits algériens, ce qui fragilise les efforts de diversification économique. Cette situation compromet ainsi la transition indispensable visant à réduire la dépendance du pays aux ressources fossiles.
Par ailleurs, cette mesure risque d’aggraver la balance des paiements algérienne. En effet, la baisse des recettes en devises étrangères, liée à la diminution des exportations, pourrait entraîner un affaiblissement du dinar, tout en creusant davantage le déficit courant. Cette fragilisation économique limiterait également la capacité d’importer des biens essentiels, notamment dans des secteurs stratégiques comme l’agroalimentaire ou les équipements industriels, indispensables au fonctionnement du pays.
Au-delà des impacts purement économiques, cette taxation élevée porte également atteinte à l’image internationale de l’Algérie. Elle reflète une incapacité à négocier efficacement ses relations commerciales bilatérales, ce qui risque de ternir sa crédibilité et sa réputation auprès de ses partenaires étrangers. Cette perte de confiance peut avoir des répercussions durables sur les investissements et les coopérations futures.
Face à cette situation, le silence actuel des autorités algériennes est inquiétant. Aucune déclaration claire ni stratégie de réponse n’a encore été formulée, ce qui pourrait accentuer la vulnérabilité du pays sur la scène économique mondiale. Or, pour inverser cette tendance, il est urgent que l’Algérie mette en place une diplomatie commerciale cohérente et proactive, notamment en renouant le dialogue avec les États-Unis afin de négocier des solutions équilibrées.
Dans ce contexte, un sursaut est impératif, une intégration plus active au sein des structures commerciales régionales, comme la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), offrirait de nouvelles opportunités pour dynamiser les échanges et réduire la dépendance aux marchés traditionnels.