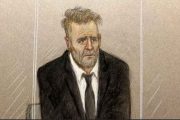Pendant le Ramadan de cette année, un phénomène vestimentaire inédit a pris de l’ampleur en Algérie. Il ne s’agit pas ici des pantalons déchirés aux genoux ou à l’arrière, portés indifféremment par les deux sexes, ni d’autres vêtements jugés indécents, même dans les pays qui les fabriquent et où ils sont considérés comme osés, réservés à certaines occasions plutôt qu’à la vie quotidienne. Le sujet qui nous intéresse concerne plutôt les nouvelles modifications apportées au voile, désormais connu sous le nom de « voile brésilien ». Ce dernier donne l’impression d’un compromis étrange : le haut du corps est couvert selon les préceptes religieux, tandis que le bas semble destiné à attirer les regards, notamment ceux des touristes et des étrangers. Ce type de tenue, loin de préserver la pudeur, semble au contraire éveiller davantage l’attention des prédateurs et des individus aux intentions douteuses.
En Algérie, pays traversant de nombreuses crises, le voile a connu une évolution progressive. Autrefois, il se résumait à une seule pièce couvrant l’ensemble du corps. Mais avec le temps et sous l’influence de plusieurs facteurs – notamment l’exposition au voile porté par les Iraniennes chiites, les programmes télévisés étrangers, l’arrivée de travailleurs africains et asiatiques, ainsi que la présence accrue de visiteurs des pays du Golfe, de touristes français et russes –, le voile s’est transformé pour ne couvrir que la tête, tandis que le reste du corps est mis en valeur et exhibé à moindre coût.
Beaucoup s’interrogent sur la nature de cette tenue : est-elle réellement un voile ? Celles qui la portent s’estiment voilées et non dévoilées, mais lorsqu’on la compare au hijab traditionnel des pays orientaux, la différence est frappante. Ce « voile brésilien » apparaît souvent plus audacieux que les tenues de certaines femmes non voilées et plus provocant encore que les vêtements portés par les prostituées de nuit, car il masque les cheveux tout en mettant en avant les formes du corps, notamment le postérieur.