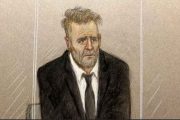Depuis cinq ans, le régime des généraux, dirigé par le général Saïd Chengriha, brandit le slogan de « l’Algérie nouvelle », qui est censé signifier un abandon de l’héritage des périodes de la Décennie noire, au cours de laquelle un quart de million d’Algériens ont été tués, et dont l’actuel dirigeant de l’Algérie, l’un des parrains et criminels de guerre de cette époque, fait partie. Pour cette raison, aux yeux de nombreux observateurs politiques algériens, incarner le slogan de « l’Algérie nouvelle » n’est pas une tâche aisée ; cela exige une rupture radicale et courageuse avec toutes les formes de gestion et de gouvernance qui ont engendré le retard dans le pays. Cela nécessite également l’élaboration d’une vision théorique fondée sur la science, la mise en œuvre d’applications pratiques sérieuses et décisives, ainsi que la reconnaissance qu’il est impossible de concrétiser un tel slogan en reconduisant au pouvoir les mêmes individus qui ont contribué à tuer des Algériens et à ancrer un retard structurel pendant de longues années, nous faisant vivre à l’époque médiévale malgré les richesses du gaz et du pétrole.
Pour répondre à ces questions, j’ai profité de ma présence en Algérie pendant le Ramadan et j’ai effectué une visite à la capitale, Alger, ainsi qu’à Batna et Annaba. Mon objectif était d’évaluer dans quelle mesure le slogan de « l’Algérie nouvelle » se concrétisait dans la réalité. Pour l’instant, je me limiterai à enregistrer quelques observations typiques, qui sont les suivantes : j’ai constaté de près les manifestations du retard et une vie digne du Moyen Âge, avec des files d’attente partout et le vol devenu une habitude chez le peuple algérien, au point que l’on peut être victime de vols de la part de n’importe qui, qu’il s’agisse d’un vieillard ou d’un enfant. Les bus de transport sont extrêmement vétustes, il n’y a ni restaurants haut de gamme ni propres, les transactions par carte bancaire sont inexistantes, les guichets bancaires sont rares, et il y a une absence totale de niveau de vie décent, de bien-être économique, de libertés d’expression, ainsi que d’un environnement architectural, qui est pourtant l’un des principaux indicateurs du progrès civilisationnel dans toute société. Parmi d’autres phénomènes observés lors de cette visite, j’ai personnellement et directement interagi avec plusieurs services administratifs, et il m’est apparu que les responsables continuent d’exercer diverses formes de contraintes symboliques et matérielles sur les citoyens. Par exemple, on remarque des files d’attente bondées devant les bureaux, où les gens sont forcés de rester debout pendant de longues heures en plein air, en plein jeûne et sous un froid glacial qui malmène leurs corps. J’ai vu de nombreux citoyens, hommes et femmes, se plaindre et protester contre la pile de documents requis pour constituer tel ou tel dossier simple, alors qu’une administration moderne repose sur l’informatique, qui stocke les différentes informations dans des administrations interconnectées, évitant ainsi aux citoyens de devoir les obtenir de manière répétitive et stéréotypée auprès des services municipaux ou des bureaux des wilayas (préfectures). Malgré la disponibilité de ces technologies, l’administration algérienne reste traditionnelle et ne fonctionne pas avec des méthodes flexibles, comme l’utilisation du courrier électronique ou du téléphone, pour réduire les déplacements des citoyens vers les services administratifs, notamment ceux situés loin. Pour cette raison, on a l’impression en Algérie que l’ère des technologies n’existe pas, malgré les milliards de dollars de revenus tirés du gaz et du pétrole, et malgré la présence de services Internet qui, malheureusement, appartiennent à la vitesse des tortues en raison de leur faiblesse aggravée.
Au cours de cette visite, j’ai également été confronté à diverses formes de violence symbolique découlant d’un urbanisme chaotique et repoussant, qui va à l’encontre des principes élémentaires de l’esthétique architecturale moderne. Cette dernière est censée contribuer réellement à ajouter des dimensions esthétiques à un État pétrolier comme l’Algérie. Il est bien connu que l’Algérie continue de patauger dans une crise du logement sans trouver de solutions satisfaisantes à ce jour. En effet, 90 % des bâtiments algériens construits aujourd’hui ne répondent absolument pas aux critères d’une architecture esthétique évoluée ; ce ne sont que des amas de béton armé dressés dans les airs sous forme de constructions discordantes, adoptant des rectangles importés de modèles de construction chinois dépassés ou imitant de manière déformée et médiocre les modèles de logement français. Ainsi, une lecture de la réalité algérienne révèle que les nombreux bouleversements qu’a connus l’Algérie n’ont pas encore permis aux autorités responsables d’en tirer les leçons, car elles n’ont pas l’intention sincère d’ouvrir le dossier des véritables causes qui ont empêché le pays d’accomplir une transition civilisée dans tous les domaines. On observe ainsi que le déficit structurel qui continue de frapper la société algérienne a engendré une conséquence grave : l’échec du pari du développement civilisationnel, de la stabilité politique et sociale.
En conséquence, les citoyens déplorent la perte de 60 ans d’autonomie accordée par la France à l’Algérie. Ce qui est également regrettable, c’est que le phénomène d’entrave au processus de développement n’a pas trouvé de diagnostic scientifique dans le cadre de la recherche académique, ni de traitement pratique pour extirper cette tumeur de manière décisive. Il semble évident que les autorités continuent de reproduire les anciennes méthodes qui ont cristallisé les crises dans la société algérienne, fermant la porte à l’activation d’un dialogue. Cela a conduit à l’accumulation de problèmes, y compris celui de l’identité algérienne. Il est véritablement regrettable que, chaque fois qu’un horizon prometteur pour instaurer un tel dialogue apparaît, des obstacles soient imposés, menant souvent à une seconde guerre civile, semblable à la Décennie noire.